Histoire des découvertes | |
| L'observation qu'une mutitude d'organismes des plus petits aux plus gros se laissent porter par les courants est ancestrale mais c'est l'invention du microscope et la découverte des "animalcules", premières bactéries, protozoaires, algues et larves au XVIIe et XVIIIe siècles qui révèle la diversité et l'abondance des organismes microscopiques du plancton que l'on commence à collecter avec des filets de mailles différentes. En ce qui concerne le macroplancton c'est à partir des années 1800 que le zoologiste Peron et le dessinateur Lesueur décrivent les premiers organismes pélagiques dans la baie de Villefranche-sur-Mer. Dans les années 1850, Vérany puis le zoologiste Vogt redécouvrent et étudient les organismes du plancton dans la baie de Villefranche. Au début des années 1880, Fol associé à Barrois puis Korotneff établissent le premier laboratoire, accueillent des biologistes prestigieux, et établissent la Station Zoologique de Villefranche comme un des premiers centres d'étude des embryons, larves et organismes du plancton. | |
Dans cette animation, on peut par exemple observer, entre le Golfe du Lion et la mer Ligure, entre la Corse et le continent, le phénomène suivant :
En hiver, le refroidissement des eaux de surface en accroît la densité, jusqu’à des valeurs égales à celles des eaux plus profondes, ce qui crée des cellules de convection mélangeant les eaux de la surface avec celles du fond.
Ces mélanges verticaux amènent des éléments nutritifs en surface, ce qui favorise la photosynthèse, mais, dans le même temps, ils entraînent le phytoplancton vers des eaux profondes non éclairées, limitant cette même photosynthèse (« tâches bleues » au large du golfe du Lion). Le résultat est une très faible productivité et des concentrations faibles en chlorophylle. Au printemps, l’augmentation de l’irradiation solaire réchauffe progressivement les eaux de surface, ce qui crée une stabilisation des eaux. Les cellules algales subissent alors moins de mouvements dans la colonne d’eau, et une photosynthèse efficace peut s'accomplir ; le résultat est une forte production de biomasse. C’est ce que l’on appelle la floraison printanière («spring bloom» en anglais), que l’on remarque très clairement sous la forme d’une grande tache verte. Cette floraison ne démarre pas chaque année rigoureusement au même moment et son intensité est également variable d’une année à l’autre (dû à des différences de température, de vent, etc).
Une fois les sels nutritifs consommés, la floraison s’éteint petit à petit, pour laisser place à une situation totalement « oligotrophe » (à savoir très peu d’éléments nutritifs) qui va se prolonger tout l’été. Les eaux sont à nouveau bien bleues.
Cette animation permet aussi d’observer l’activité tourbillonnaire, caractéristique de la circulation des eaux en Méditerranée, par exemple en mer d’Alboran, juste derrière le détroit de Gibraltar. Dans cette mer s’affrontent les eaux provenant de l’Atlantique et entrant à la surface, et des eaux plus salées, formées en Méditerranée, et ressortant plus profondément. Cette confrontation est à l’origine de la présence de fronts (comme les fronts météorologiques) et génère des tourbillons, très bien visibles sur l’animation. On observe aussi très bien l’intense activité tourbillonnaire le long des côtes de l’Algérie.
Les changements saisonniers de l’extension des zones côtières, où les eaux sont plus turbides (à savoir chargées de sédiments) s’observent aussi, par exemple à l’embouchure du Rhône, du Nil et du Pô, et dans le golfe de Gabès où la profondeur est faible.
La concentration en phytoplancton a un effet sur la «couleur de la mer». En effet, le phytoplancton contient de la chlorophylle (comme les plantes terrestres), qui lui permet d’utiliser l’énergie lumineuse pour engendrer le processus de photosynthèse. Cette chlorophylle à la particularité d’absorber plutôt les longueurs d’onde du bleu et beaucoup moins celles du vert. Par conséquent, plus la chlorophylle est abondante, plus le rayonnement est atténué dans le bleu, et plus les eaux apparaissent vertes. C’est ainsi que les eaux de la Méditerranée orientale ont une couleur bleu indigo tirant sur le violet (très peu de phytoplancton), que celles de la mer Ionienne et de beaucoup d’autres régions de la Méditerranée sont simplement d’un beau bleu profond (un peu plus de phytoplancton), et qu’elles ne prennent une couleur verdâtre que très localement et temporairement, par exemple vers les mois de mars et avril au milieu de la mer Ligure, entre la Corse et le continent. Plus près des côtes ou près des embouchures de fleuves (Pô, Nil), la couleur de l’océan est également modifiée par la présence de sédiments en suspension et de substances dissoutes aux propriétés d’absorption plutôt diverses.
Donc, s’il existe une relation relativement stable et générale entre la couleur de la mer et la concentration en phytoplancton dans les eaux du large, les choses sont plus compliquées, et surtout différentes d’une région à l’autre, lorsque l’on s’intéresse aux eaux côtières.


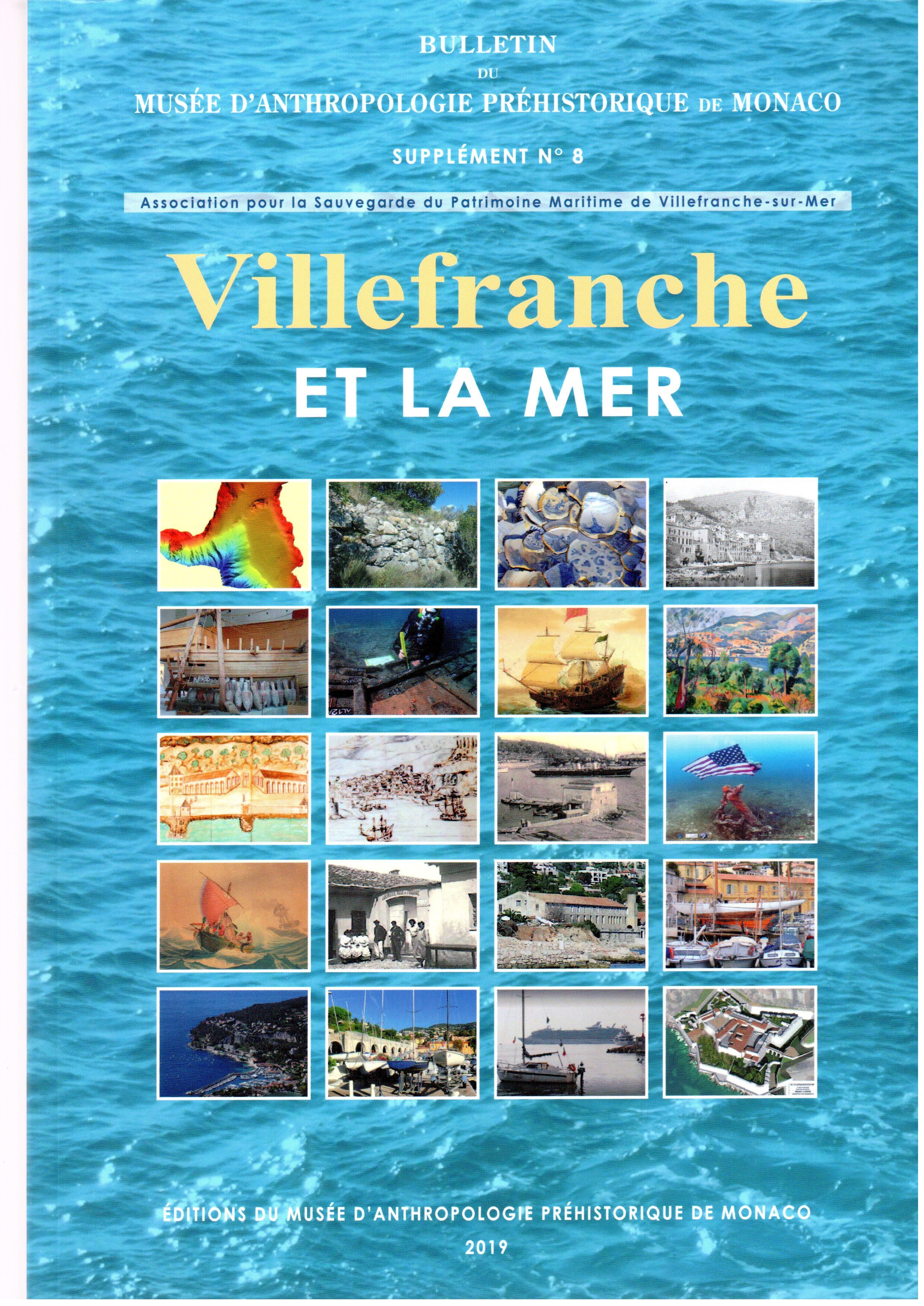 Les actes du colloque "Villefranche et la mer" organisé par l'ASPMV qui s'est tenu en octobre 2017 à la citadelle de Villefranche sont parus fin octobre 2019. Les 400 exemplaires de ces actes ayant été rapidement épuisés, une réédition vient d'être faite. En vente à l'association ou, prochainement, dans les librairies
Les actes du colloque "Villefranche et la mer" organisé par l'ASPMV qui s'est tenu en octobre 2017 à la citadelle de Villefranche sont parus fin octobre 2019. Les 400 exemplaires de ces actes ayant été rapidement épuisés, une réédition vient d'être faite. En vente à l'association ou, prochainement, dans les librairies 