| Pour se maintenir en suspension et se déplacer, la plupart des organismes du plancton utilisent des systèmes de motilité et de locomotion, tels contractions du corps (cf: Zoothamnium pelagicum, méduses), battements répétitifs d’extensions de la surface corporelle (cils des tintinnides, flagelles des dinoflagellés, appendices locomoteurs des copépodes...), mouvements d’appendices spécialisés tels que les nageoires des mollusques pélagiques. Il existe aussi des organes de déplacement et maintien dans la couche d'eau (palettes ciliaires des cténaires, ombrelle des méduses...)
Pour se nourrir et assurer leur croissance, les planctontes dépendent étroitement de leur environnement. Les sels minéraux et les petites molécules organiques en solution dans l’eau de mer sont absorbées directement. Les particules inertes provenant des déjections des organismes vivants et des individus morts qui composent la « neige planctonique », constituent une base de nourriture non négligeable. Avant d’être ingérées, les proies vivantes sont capturées et immobilisées grâce à des systèmes souvent très sophistiqués tels que les extensions cytoplasmiques des protozoaires, les filaments pêcheurs garnis de cellules à venin des cnidaires (cnidocystes) ou les pattes mâchoires des crustacés.
Les copépodes sont les représentants les plus nombreux de ce monde de la miniature . A eux seuls, ils forment plus de 80% des individus du plancton. Pour rechercher leur nourriture, ils sont capables de mouvements verticaux journaliers de grande amplitude appelés migrations nycthémérales. Certaines espèces parcourent ainsi 500 m dans la colonne d'eau, alternativement vers la surface et vers les profondeurs.
Références bibliographiques :
Tregouboff, G. et Rose, M. 1957. Manuel de planctonologie Méditerranéene. CNRS. I (texte), 587p. - II (illustrations) 207 pl.
Ruppert E.E., Fox R.S., Barnes R.B. 2004. Invertebrate Zoology, A Functional Evolutionary Approach, 7th ed. Brooks Cole Thomson, Belmont, CA. 963 p. Liens : Site du Marine Biological Laboratory (MBL) de Woods Hole
www.mbl.edu
Waikiki Aquarium : Marine life profiles, Invertebrates
http://waquarium.mic.hawaii.edu/MLP/invert.html
Site du Friday Harbor Laboratory (FHL)
http://depts.washington.edu/fhl/zoo432/plankton/plintroduction/plintroduction.htm#collection
Site de la Station Biologique de Roscoff (en anglais)
www.sb-roscoff.fr/Phyto/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 | 










































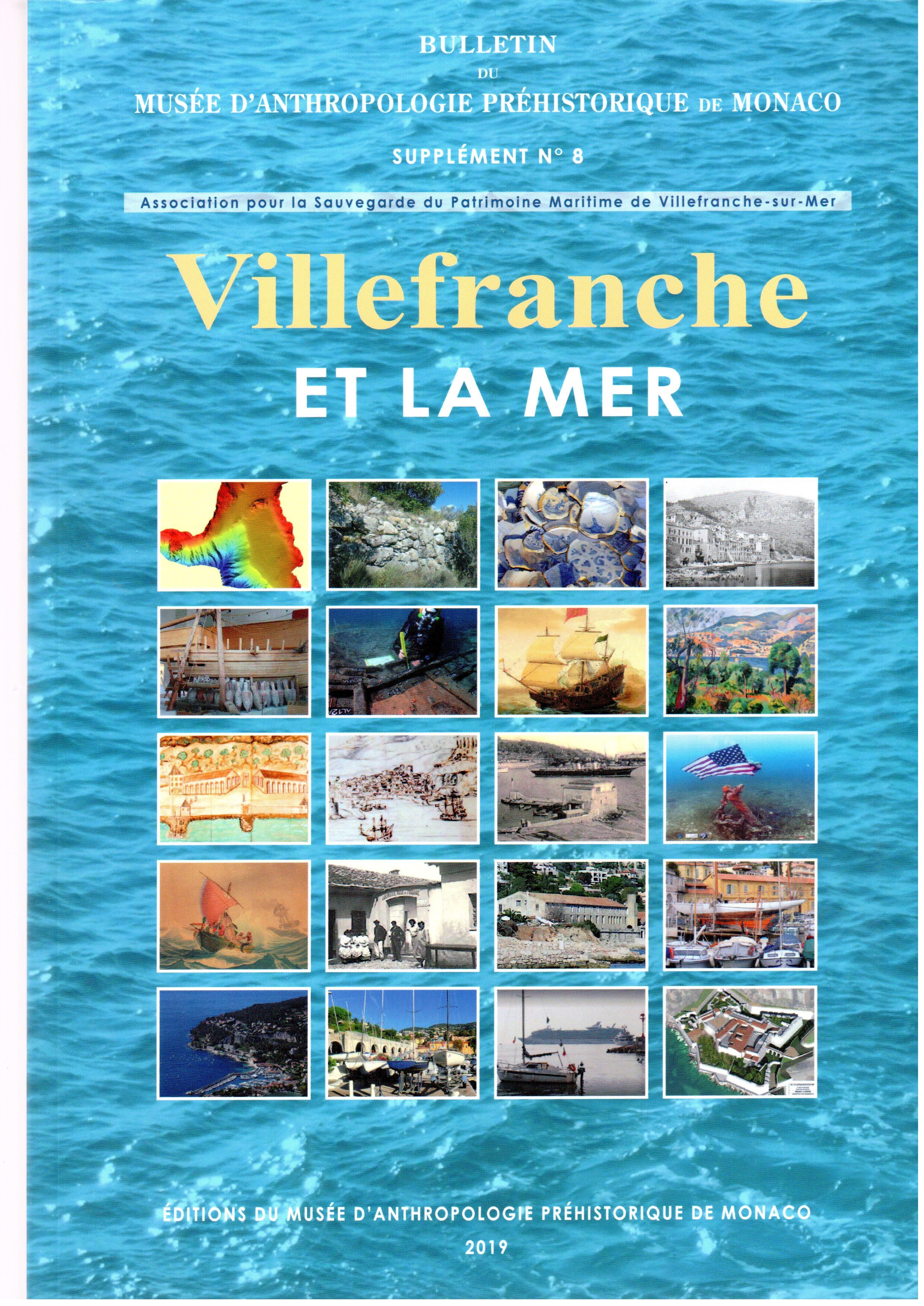 Les actes du colloque "Villefranche et la mer" organisé par l'ASPMV qui s'est tenu en octobre 2017 à la citadelle de Villefranche sont parus fin octobre 2019. Les 400 exemplaires de ces actes ayant été rapidement épuisés, une réédition vient d'être faite. En vente à l'association ou, prochainement, dans les librairies
Les actes du colloque "Villefranche et la mer" organisé par l'ASPMV qui s'est tenu en octobre 2017 à la citadelle de Villefranche sont parus fin octobre 2019. Les 400 exemplaires de ces actes ayant été rapidement épuisés, une réédition vient d'être faite. En vente à l'association ou, prochainement, dans les librairies 